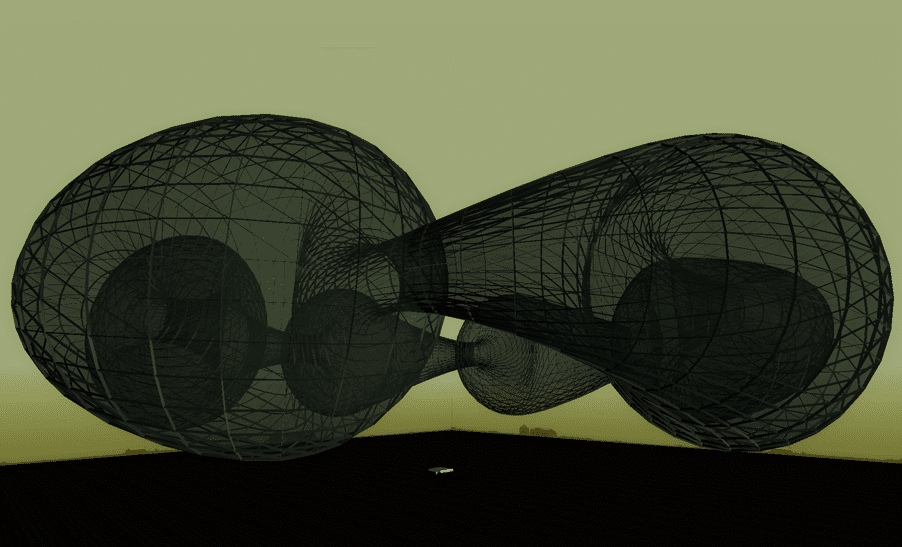Psychiatre et psychanalyste, Sarah Stern nous offre le récit très personnel de l’activité qu’elle exerça pendant plus de dix ans au sein de la maternité d’un hôpital en Seine-Saint-Denis. Rencontres entre une jeune femme à l’écoute et de futures mères ou de nouvelles accouchées, souvent dans une situation précaire et coupées de leur parole, et aussi confrontation avec l’institution hospitalière et républicaine forment la trame de cet ouvrage à l’écriture vive.
« Le vendredi matin, on m’appelait de loin en loin pour un épisode délirant chez une jeune accouchée ou pour établir la prescription d’une patiente toxicomane. Le plus souvent j’attendais dans mon bureau vide. Le téléphone sonnait si peu qu’il m’arrivait de vérifier qu’il fonctionne. […] Je prenais l’habitude de cette étrange matinée […] dans ce rez-de-chaussée où tout le monde semblait si affairé. […] Après quelques mois, on me les adressa, pour insomnie, tristesse, troubles du comportement, consommation de toxique… Très vite, si on laisse dire celui qui parle, viennent les pensées obsédantes et les ruminations, traces des évènements qui n’ont jamais cessé d’avoir lieu. Cela apparaît toujours inouï, que quelqu’un se mette à parler de ce à quoi il ne peut se confronter, de ce qui lui échappe. » La première patiente, c’est l’auteure, et faire preuve de patience, se sortir de l’affairement hospitalier, paye. Les patientes viennent dans ce lieu où on laisse dire. La consultation du vendredi matin deviendra une unité de soins à part entière.
Nous les voyons défiler. Mme A, hiératique, silencieuse, intimidante dans sa robe traditionnelle grise à capuche, à la grossesse invisible de cinq mois, refuse d’envisager de s’occuper du bébé à sa naissance. Elle a dix-neuf ans, elle en paraît le double. « Ce n’est pas un sourire, mais quelque chose s’est ouvert en elle. Elle consent à être là. » Confrontée à l’écoute de Sarah Stern, elle arrive à mettre des mots sur l’impensable. Son père est mort, sa mère l’a envoyée en France chez son oncle dont on vante au pays la grande réussite alors qu’il se débat et vit chichement avec sa famille dans un minuscule appartement. L’oncle la confie à un compatriote, « bientôt l’habitude est prise qu’elle subisse ses assauts ». D’interruption de grossesse, il n’a jamais été question pour des impératifs religieux. Restent les multiples options, abandonner le nouveau-né, le faire reconnaître par son père, vivre ou non avec lui, retourner au pays. Dans le bureau vide, la parole peut se faire pleine.
Mme T, elle, est dans l’incapacité absolue de s’occuper de son nouveau-né. Sarah Stern lui fait découvrir qu’elle l’associe avec le grand prématuré que sa mère avait ramené chez elle contre l’avis des médecins quand elle avait huit ans. Elle assiste alors à ce combat acharné de sa mère, à son ravage absolu. Il y a aussi ce jeune garçon accompagnant sa mère à la consultation qui ne cesse de lui demander : « deux fois dix, ça fait combien ? » jusqu’à ce que la psychiatre, qui est aussi psychanalyste, lui tende une feuille sur laquelle elle a dessiné une bouteille de vin : « c’est bien ça ? ». Et la mère d’évoquer l’alcoolisme du père qu’il s’agit de cacher.

Toutefois, Les patientes n’est pas un recueil de cas, ceux-ci viennent illustrer une pratique. « Chaque fois la consultation est le moment de confrontation au réel, où l’on interroge le possible, sonde les désirs. Le consultant est neutre, en ce qu’il ne veut rien pour elles sinon leur permettre de poser un acte, de ne pas faire l’objet d’une décision qu’elles ne pourront assumer. » Cette pratique est incarnée, et c’est un intérêt majeur du livre : l’auteure ne se drape pas dans une fonction, elle nous invite à suivre ses découvertes, ses questionnements. « En prenant ce poste, je n’avais pas imaginé que travailler dans une banlieue où vivaient nombre d’immigrés changerait la clinique. Universaliste […], je me trompais. » L’enseignement qu’elle a reçu ne lui est pas d’un grand secours ; les liens avec sa propre histoire, « enfant d’immigrés, illégitime de tant de façons, marquée en fin de compte d’une singularité héritée, familiale et sociologique liée à la grande Histoire », elle les découvre, les évoque avec pudeur.
Ce qui scande le récit, c’est le vécu de Sarah Stern : « Les commencements », « Le travail de parole », « Des usages de la profession », « Du pouvoir », « Ma mère »… sont autant de titres de chapitres où le lecteur partage les réflexions de l’auteure, notamment sur la psychiatrie. Entre ses affectations avec un patron condescendant, ou au sein d’un hôpital dans un état d’abandon et de déshérence impressionnant, ou encore dans un service universitaire bâti sur le modèle des services de médecine, et la disparition d’une nosologie structurante au bénéfice d’un repérage de symptômes, son regard, toujours empreint d’un certaine ironie, n’est pas tendre. « Dans les années 1980 la réforme de la psychiatrie italienne, menée par Basaglia, va entraîner derrière elle toute l’Europe, les vues des désaliénistes rencontrant inopinément celles des gestionnaires. » Des milliers de lits sont fermés, l’accompagnement censé se mettre en place étant des plus indigents. « Les villes d’Europe s’emplissent de SDF, délirants hallucinés, alcooliques marmonnants, toujours gris et qui, en quête d’une instance à qui s’adresser, invectivent parfois le badaud. Voilà ce qu’auront donné, en fin de compte, les rêves de structures alternatives à l’asile », remarque-t-elle.
Restent donc des initiatives à l’image de celle que la patiente Sarah Stern a su mettre en place avec ses patientes. « Il ne s’agit pas de raconter ces vies, mais ce qu’elles ont à en dire à celle qui se tient là à ce moment de leur histoire. Parce que dire le désir, en plein ou en creux, ce qui aurait pu, ou n’aurait pas dû, arriver change imperceptiblement le cours des choses. » Mais il n’est pas certain que l’organisation actuelle des soins médicaux et psychiques, son apparente rationalisation, rende le travail relaté dans ce livre toujours possible, souligne l’auteure. « À ce titre, il constitue donc un témoignage, déjà une archive et un plaidoyer », écrit-elle en conclusion. Le plaidoyer est assurément une réussite. Il est à soutenir.