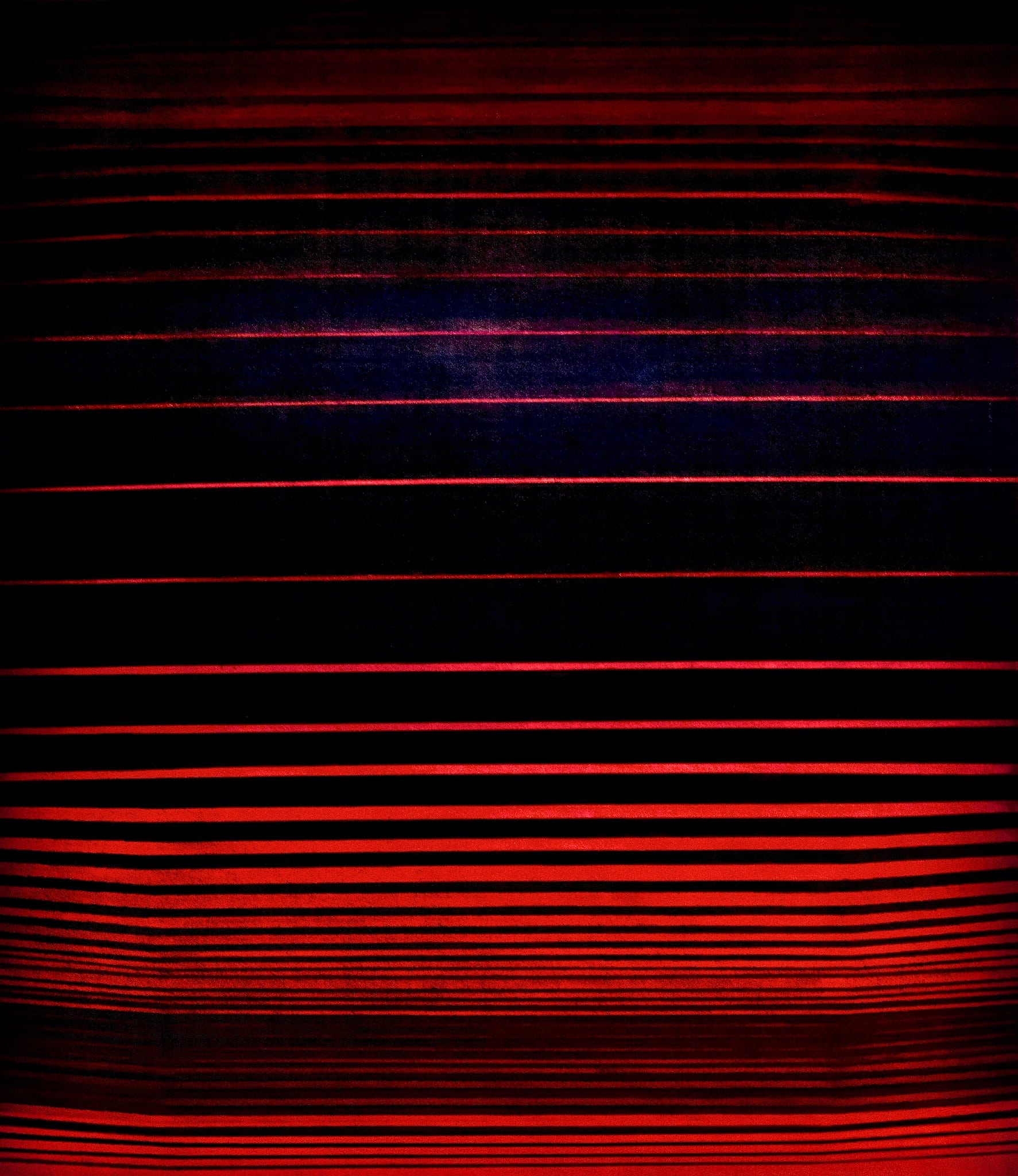Solito de Javier Zamora est porté par l’énergie d’une voix. Celle d’un enfant entraîné dans un voyage effarant entre le Salvador et les États-Unis pour passer illégalement la frontière et retrouver ses parents. Entre récit quasi documentaire et autobiographie, l’auteur parvient à écrire un récit à la hauteur de son sujet et de son expérience.
Bien souvent, trop souvent, les écrivains se contentent de sujets ou de thèmes, attrapant, comme au vol, ce qui agite, travaille la société, pour l’introduire dans une fiction, le transmuant en moteur du récit. Il y a là quelque chose de mécanique et de paresseux qui confond vaguement la littérature avec la sociologie, la psychologie, l’histoire, la politique ou la morale. Non que ces matières ne s’incorporent pas dans les fictions, mais l’enjeu prend trop le pas sur la forme, et la conséquence se fait cause. On donne aussi prime à ce qui est vrai, nourri du réel. C’est la fameuse et omniprésente formule « inspiré d’une histoire vraie » qui paraît devoir valider toute forme de récit confessionnel et l’ériger au rang d’art immédiatement et sans question.
Deux traits qui s’adjoignent bien souvent pour produire des récits de qualités diverses, souvent englués dans une émotivité un peu nauséeuse et dont on ne sait trop que faire finalement. Bien sûr, les livres parlent du monde comme il va ou ne va pas, ils conforment des expériences, les diffractent, les admettent dans un grand partage. Et cette fonction vitale du récit peut, doit probablement, se méfier et se libérer de ces tendances quelque peu pavloviennes et réductrices. Car la démagogie de l’émotion, le sensationnalisme ou la tyrannie de l’identification immédiate et univoque, empêchent de penser et masquent des œuvres qui prennent à bras-le-corps les grands sujets de notre époque – il y a assurément des textes puissants sur le racisme, la sexualité, la guerre, le terrorisme, l’argent… –, et qui excèdent leur condition tout simplement, débordent les habitudes et proposent des formes ou des biais neufs pour s’en saisir.

Et c’est à cela que parvient Javier Zamora dans Solito, premier récit en grande partie autobiographique qui raconte avec une simplicité désarmante le voyage semé d’embûches d’un gamin de neuf ans qui traverse, accompagné seulement d’adultes inconnus, l’Amérique centrale du Salvador aux États-Unis où l’attendent ses parents. Ainsi, le livre suit, comme un journal daté plein de suspense, la longue traversée de cet enfant perdu dans le monde des grands, qui suit le mouvement vers une destination qu’il n’a cessé d’imaginer et qui paraît inaccessible. L’écrivain nous décrit tout avec méticulosité sans jamais s’effrayer de la répétitivité et semble incroyablement s’affranchir des règles du récit. Car l’expérience dépasse tout, emporte tout. Non qu’elle soit indiscutable ou supérieure par nature, mais parce que cette forme fluide, phénoménologique, semble parfaite pour exprimer ce grand passage, une odyssée minuscule qui semble se recommencer toujours. Javier Zamora parvient à raconter ces quelques semaines de sa vie d’enfant comme si tout se repassait vraiment.
Solito considère une violence intolérable, fait quelque chose de l’effroi de la réalité.
Et il nous y loge, nous accueillant dans un récit qui frôle souvent l’indicible sans jamais se complaire dans une exhibition indécente. Le lecteur découvre tout, en même temps que ce petit héros qui n’en est pas un, dans une sorte de simultanéité qui produit une lecture altérée, comme extraite des règles de la fiction commune. On est puissamment happé par tout ce qu’il raconte, dans le saisissement prospectif qui porte un livre dense et long. On découvre avec le petit Javier tous les aléas du voyage, la peur des contrôles quand on fait semblant de dormir, les nuits passées « serrés comme dans une boîte d’allumettes » dans des chambres où il ne faut rien allumer, les rencontres avec les autres clandestins plus ou moins rudes et francs, les transferts de passeurs en passeurs dont on ne sait pas les noms, les ordres aboyés, les traîtrises ignobles, l’argent qui manque toujours, la peur de la « migra » qui traque les illégaux et des gringos dont on ne sait jamais ce qu’ils pensent, les bruits du désert, la soif dévorante, la cage du centre de rétention, l’horreur du processus administratif, les effrois de la solitude, le froid saisissant, l’attente permanente et le rien qui ne se passe… Mais on découvre avec lui aussi la beauté des paysages, les jeux avec Carla, la tendresse de sa mère Patricia qui le prend sous son aile, l’amour pour son grand-père et son abuelita, ses tantes qui se maquillent un peu trop, les intonations de l’espagnol qu’il découvre en allant vers le Nord, toutes les histoires peuplées de Dragon Ball Z et de Superman qu’il se raconte, ses rêves de petit garçon qui veut retrouver ses parents et qui rêve d’une vie nouvelle dans ces mystérieuses Americas…
Solito aurait pu se limiter à cela, un témoignage bien écrit et bien construit qui raconte l’expérience d’un enfant migrant. Quoi de mieux pour faire pleurer dans les chaumières et nous fournir un exutoire à bon compte pour notre indifférence ? Quel thème plus porteur, alors que les pages des journaux débordent d’histoires atroces et que les politiques migratoires semblent condamnées à se durcir encore davantage ? Évidemment, il y a quelque chose qui résiste (tout en en exploitant les ressorts, soyons lucides !) dans le livre de Javier Zamora à ces traits de l’époque. C’est qu’il réussit à se raconter en concevant la forme du discours qui le lui permet. Et c’est, croit-on, un geste autobiographique de grande ampleur – on pense souvent en le lisant à des textes d’Aharon Appelfeld qui confrontent l’enfance à l’horreur de l’histoire en mouvement – que de trouver une manière de faire récit qui soit à la hauteur de l’horrible expérience qu’il confie. Car si l’on pense souvent à des écrivains comme John Edgar Wideman et à Suis-je le gardien de mon frère ? ou au dernier livre d’Erri De Luca, Zamora ne fait jamais le choix ni de l’analyse conceptuelle ou morale, ni de la fable, il trouve une distance (qui semble ne pas en être une) entre ce qu’il raconte et ce qu’il choisit de raconter. L’écrivain se joue ainsi de cette simultanéité avec une virtuosité frappante.
Il réussit à se raconter en concevant la forme du discours qui le lui permet. Et c’est, croit-on, un geste autobiographique de grande ampleur.
Ce choix obéit probablement à la tension qui habite Solito entre le récit quasi psychanalytique fait pour soi et un témoignage pour les autres. Comme si le livre avait en même temps une valeur intime et extime. Comme s’il relevait à la fois de l’autobiographie phénoménologique, expérimentale et chronologique, et d’un texte qui gagne une dimension politique très forte. Et comme Zamora est écrivain et pas moraliste ou exhibitionniste, il joue de cette tension dans la forme de son texte, cette sorte de voix intérieure qui balaie les événements, et non dans un appareillage qui l’encombrerait. Ainsi, son livre fait penser le réel, le politique, les enjeux migratoires, humanitaires et moraux, sans jamais faire la leçon, en exhibant simplement ce qui se passe, la violence, l’effroi, ce que son personnage comprend ou ce qui lui échappe – et que nous sommes obligés, nous, de penser. Solito considère une violence intolérable, fait quelque chose de l’effroi de la réalité. Le livre, en adoptant le point de vue du garçonnet, sans jamais y interférer de manière extérieure, en obligeant à la partialité d’un regard – il y a quelque chose de très dickensien dans le procédé –, rend possible de raconter quelque chose qui autrement serait soit totalement voyeuriste, soit strictement intolérable.
La force du livre de Javier Zamora réside dans une capacité à concevoir, sans la mettre en scène dans le texte, une réflexivité sur ce que le récit de soi produit. Son texte est ainsi beaucoup plus théorique qu’il n’y paraît, plus détaché en quelque sorte de son sujet autobiographique. Car si l’on comprend l’impériosité de ce récit pour l’existence de l’homme, il faut admettre que raconter les pérégrinations de ce gamin qui passe clandestinement l’une des frontières les plus emblématiques du monde, revient aussi à le penser dans le grand passage de l’écriture, des choix qui portent le récit. C’est en devenant écrivain, en faisant quelque chose de l’expérience, qu’on trouve la force de rejouer sa vie, de raconter ce qu’il faut avoir vécu pour le raconter. Et l’on perçoit, à lire l’odyssée du petit Javier, qu’être à la hauteur de ce récit-là, pour soi, comme pour les autres, est d’une importance vitale.