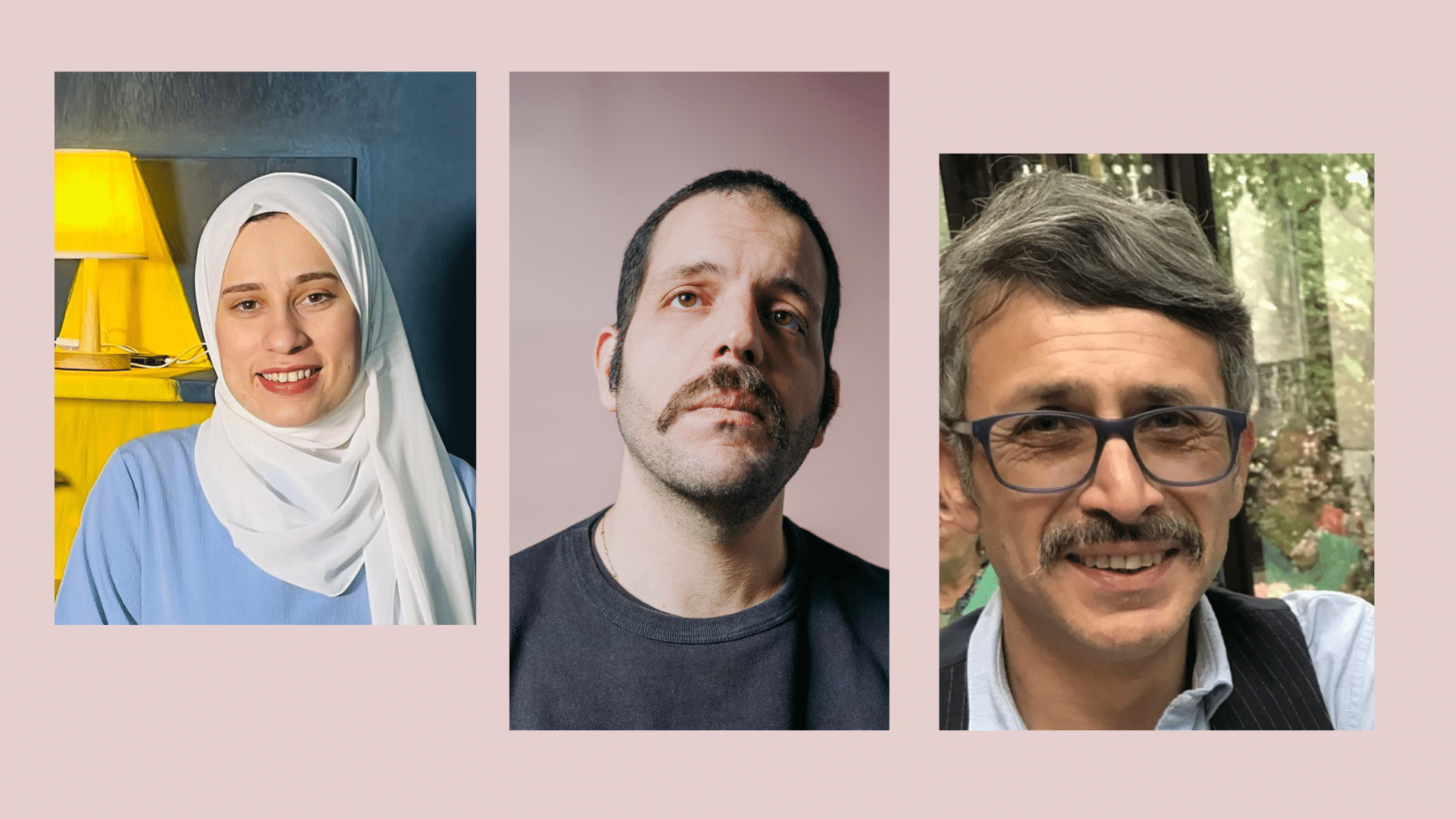La cruauté à l’œuvre, fantasmatique ou pas, vis-à-vis de soi-même ou des autres, la cruauté au cœur d’une œuvre… voici Printemps sombre de Unica Zürn et Bébé rose de Jean-Luc Caizergues, qui en répondent, qui se répondent, chacun à leur manière.
« C’est un texte qui trouble », note l’éditrice dans sa présentation de Printemps sombre. Le livre d’Unica Zürn fait bien plus que troubler. Il horrifie et il bouleverse. Pourtant, à notre époque, nous devrions être habitués, lisons articles, livres, regardons films, images qui vont loin dans l’audace érotique, la barbarie et la violence. Si loin que semble-t-il on ne peut pas faire mieux.
Unica Zürn ne fait pas mieux, pas pire non plus, elle est elle-même, telle qu’on la connaissait déjà puisqu’on la connaissait, présentée, proposée par les surréalistes et surtout par Bellmer dont elle fut l’égérie, le modèle, la compagne durant de longues années. Cependant, désormais on la lit, l’envisage autrement, extirpée, dégagée et même débarrassée de ses mentors, parrains, étouffants et morbides et on essaie, à travers elle, d’analyser les formes dont peut se revêtir l’érotisme féminin.
Pour autant sommes-nous davantage capables d’analyser le sien, d’en comprendre les sources, il ne peut que gêner toute femme moderne tant il va à l’encontre des idées actuelles sur le refus de se soumettre et la nécessité, d’avant tout, consentir.
Plutôt que de plaquer sur son comportement des jugements de notre siècle (tels que songer aux spoliations dont ont été victimes les pays coloniaux quand le père offre à Unica des objets ramenés de pays exotiques ; décider qu’Unica intériorise sa soumission…), replaçons-la dans le contexte de son époque, pour éviter de remplacer des manières de penser discutables par de nouvelles, trop limitées.
Vers le milieu du XXe siècle, quand Unica offrait son corps, nu et lié par Hans Bellmer sur une photographie d’une séance de bondage, elle n’était pas la seule. On découvrait Colette Peignot, morte juste avant la guerre et on la publiait sous le prénom de Laure. Leur sadomasochisme allait de pair avec un viol subi enfant ; et ne se bornait pas à de simples fantasmes : la mort ne les effrayait pas. Signé Pauline Réage, paraissait Histoire d’O, aux éditions Jean-Jacques Pauvert. Toujours vers cette époque, Klossowski ravissait ses lecteurs avec des livres sur sa femme qu’il prénommait Roberte et montrait nue, fouettée sur des photos et dans un film. Ceci pour ne citer que les ouvrages les plus connus où les femmes concernées, en se livrant aux rites de la dépossession de soi et de la possession par d’autres, étaient prétendues libres et en accord avec elles-mêmes.

Ou plutôt non. Seuls s’exprimaient vraiment les hommes, seul prévalait leur point de vue. Et quand la femme donnait le sien, il n’était pas considéré, pris au sérieux, Unica était folle, Pauline Réage n’existait pas et Denise Klossowski ne révéla jamais en quoi elle adhérait au personnage de Roberte. Unica, comme Denise, étaient passées par le nazisme, la première, Allemande et vivant à Berlin, la seconde internée pour fait de résistance.
Ceci explique-t-il cela ? Si l’on en vient à Printemps sombre, récit autobiographique déjà paru et reparu mais dans la traduction de Ruth Henry et sous le titre Sombre printemps comme le signale Lucie Taïeb, les faits sont beaucoup plus complexes. Unica est une enfant en mal d’amour. Ses parents divorcés, elle ne voit plus son père qu’elle adorait et se retrouve avec une mère distante et un beau-père haut-dignitaire nazi. Elle a une dizaine d’années. Dans le même temps, elle découvre le plaisir solitaire, qu’elle alimente et qu’elle excite par des fantasmes où elle se vit en victime consentante. Jusqu’au jour où elle tombe amoureuse d’un beau jeune homme d’une vingtaine d’années, croisé à la piscine. Et soudain Unica pourrait devenir autre, une petite fille qu’on aime d’amitié, avec délicatesse. Mais le destin refusera qu’elle soit heureuse et rassurée. Le livre se termine par un suicide prémonitoire.
Il est écrit d’un seul élan, du point de vue de la fillette, dans un ton et une forme parfaitement restituées par l’actuelle traduction ; avec un dénouement vu par l’autrice, adulte, qui le commente brièvement. Très éprouvant, dans sa première partie, et bouleversant dans la deuxième, répétons-le. D’abord parce que biographique. Ensuite pour ce qu’il montre de sa précocité dans les fantasmes et le plaisir. Enfin parce qu’il trace un destin sans merci, revivant, en adulte, un condensé de son enfance, passant du frère violeur à Hans Bellmer, et du jeune homme de la piscine à l’écrivain Henri Michaud : le premier, « l’Homme-poubelle » ? Le second, « l’Homme-Jasmin » (voir le précédent livre d’Unica Zürn publié par Ypsilon, MistAKE & autres écrits français) ? Qu’aurait été son érotisme si elle avait vécu une enfance plus sereine, et rencontré, adulte, d’autres hommes que Bellmer et les Surréalistes ? Impossible à savoir. De même qu’il nous faudrait des études objectives et plus dépassionnées pour démêler ce qui, dans la tendance au masochisme, procède d’une lointaine histoire commune. Religieuse, politique. Certaines, certains ont commencé à se risquer en terrain vierge, à remonter à la genèse, et bien avant. Mais il y a encore beaucoup à découvrir.
Quand Unica Zürn achève « L’Homme-Poubelle », (extrait de son journal qu’on peut lire dans MistAKE), par « Ici, au Château du Marquis de Sade, les Petits Prince s’amusent à dessiner des petits Bonshommes-Poubelle […] », Jean-Luc Caizergues achève le sien par un poème qui fait curieusement écho :
Retour au château
2 messieurs
costumés
de blanc
me font
traverser
mon
Royaume
en carrosse
qui me
ramène
à l’
Hôpital
Chez lui comme chez Unica Zürn, le Château est celui du Marquis et en même temps un hôpital : dans les deux lieux, la souffrance, les tortures sont les mêmes. Mais alors que l’autrice puise dans sa propre vie la matière de son œuvre, l’auteur achève avec ce dernier livre une trilogie inaugurée en 2004, qu’il qualifie de « poésie-fiction ».
La plus grande civilisation de tous les temps, premier livre de la trilogie et publié en 2004, puisait, dans les romans ou les articles de journaux, des faits divers sinistres réduits à l’essentiel, à savoir quelques mots égrenés en descendant la page, poèmes réduits à l’os, qui pouvaient être lus comme fantaisies macabres ou bien évocation de l’horreur ordinaire dans laquelle nous baignons.
Dès lors, sans se presser, de sept ans en sept ans, Jean-Luc Caizergues poursuit, avec Mon suicide,
En grève
Je m’assois
par terre
je mets
les doigts
dans la
prise élec-
trique et
j’attends
patiem-
ment que
le courant
revienne.
puis avec Bébé rose, ce que son éditeur appelle « sa joyeuse entreprise de destruction du paysage contemporain ». Dans les trois cas, le livre est construit en trois temps : la construction est rigoureuse, autant que la mise en pièce est systématique, rageuse, et humoristique.
Qui est Jean-Luc Caizergues ? Un auteur très discret, qu’on ne rencontre pas, qui ne fournit pas de photo, qui vit loin de Paris. Il a été, de 1979 à 2018 machiniste à l’Opéra de Montpellier, « ce qui, ajoute toujours son éditeur, l’a tenu à l’écart du monde littéraire ». Mais ne l’empêche pas, tant par ses procédés que par son univers, d’être furieusement moderne. Contrairement à d’autres, et même s’il est resté peu célébré, son premier livre n’a pas vieilli du tout.
Les poèmes squelettiques de Bébé rose dérangent. En même temps, ils font rire tant l’horreur est énorme et tant l’auteur semble impassible. L’humour niche dans le titre ou dans le dernier vers, comme un poison qu’on n’attend pas.
Trop sale
Maman
grande sœur
piscine.
Grand frère
petit frère
baignoire.
Petite sœur
une douche
et bébé
la machine
à
laver
Quel est donc mon destin ? demande le narrateur à la fin du volume. Prétendu meurtrier ou malade, il est incarcéré au Château-Hôpital. Pourtant les vrais coupables, les monstres sont ailleurs, ce qui veut dire partout. La preuve en est fournie, jour après jour, dans les journaux, sur nos écrans, parfois dans nos intimités.