Plusieurs parutions récentes interrogent ce que les luttes contre les violences sexuelles font à nos manières de lire et de relire les œuvres du patrimoine littéraire. Ces essais interrogent la mémoire des œuvres du passé telle qu’elle s’est construite à travers une longue histoire critique, relayée par l’institution scolaire et universitaire. Tout en revenant sur cette histoire, leurs autrices invitent à juger sur pièce, c’est-à-dire à revenir aux textes. Reprenons. Et pour cela, rouvrons les livres que nous pensions connaître.
Les interprétations, comme les traductions, sont toujours datées. Certaines font date, sans prétendre épuiser la signification des œuvres littéraires. Elles révèlent ce qu’un contexte historique et culturel rend visible dans un tableau, un film, un livre. Elles tirent un fil de l’écheveau de significations qui se déploie à partir d’un texte. Elles interrogent ce qui, en lui, résonne dans notre présent. Nous lisons, explique Yves Citton, pour éclairer les temps où nous vivons à la lumière différée des œuvres du passé, tandis que l’époque modifie en retour ce que nous comprenons d’un texte. Dans le paysage éditorial français, ce geste d’actualisation apparaît comme une manière de répondre, depuis la critique littéraire, à des violences sexuelles systémiques. Aujourd’hui, écrivent les féministes, nous relisons Les liaisons dangereuses, les contes de Perrault, Hurlevent et Dom Juan avec ce que #MeToo et le procès des viols de Mazan ont contribué à révéler à propos des rapports sociaux de sexe. Avec la conscience, aussi, que nos manières de lire participent, au moins symboliquement, à la structuration de ces rapports. Et peut-être à leur transformation.
Si on relit attentivement Le Petit Chaperon rouge, comme le propose Lucile Novat dans De grandes dents, on découvre que les interprétations successives du conte dissimulent peut-être un malentendu. Chacun, chacune connaît l’histoire de l’enfant portant son pot de beurre et qui finit dans le ventre du loup. Mais il se pourrait que le conte n’ait pas d’abord pour but de mettre en garde contre les inconnus qu’on croise dans les forêts. Peut-être s’agit-il avant tout de susciter la méfiance envers les prédateurs doucereux qui invitent les enfants à les rejoindre dans le lit familial pour mieux les dévorer. Pour Jennifer Tamas, ce sont les œuvres du Grand Siècle, d’Andromaque à La princesse de Clèves, qu’on gagne à rouvrir et à dépoussiérer. Dans Au NON des femmes, elle exhume dans la littérature de l’âge classique une collection de refus et de résistances féminines que les commentaires avaient largement contribué à éclipser. Et que penser des sentiments orageux qui animent Heathcliff ou Julien Sorel, des « histoires d’amour » que raconteraient Duras dans L’amant ou Proust dans La prisonnière ? Pour Sarah Delale, Élodie Pinel et Marie-Pierre Tachet, la fascination critique pour ces récits est révélatrice d’une tendance à valoriser les comportements abusifs et violents envers les femmes et à occulter la question du consentement. Dans Pour en finir avec la passion, les autrices interrogent ainsi la manière dont les fictions se donnent comme des modèles où se façonnent des comportements amoureux parfois délétères.

Lire en féministe ne recouvre sans doute pas un paradigme interprétatif unifié. Mais la proximité temporelle de ces parutions invite à écouter les échos entre des ouvrages où s’élabore, depuis des références théoriques très variées, un imaginaire commun de ce que peut signifier aujourd’hui relire les textes du patrimoine littéraire à travers le prisme d’un engagement féministe. Relire en féministe, c’est d’abord répondre, en la contestant, à une mémoire sélective de la littérature. C’est ainsi réfuter une tradition interprétative qui aurait nourri le « malentendu », selon Lucile Novat, et enfermé les classiques dans un « regard masculin » dont Jennifer Tamas propose de les affranchir. D’où un rapport parfois polémique à des lectures jugées dominantes dans l’institution littéraire. Pour en finir avec la passion, en particulier, conteste une critique universitaire qui se concentrerait sur la dimension esthétique des œuvres au risque d’oblitérer leur charge politique. Pour Sarah Delale, Élodie Pinel et Marie-Pierre Tachet, il s’agit de répondre au discrédit qui frapperait les lectures « éthiques » comme celles qu’elles proposent, particulièrement en France où de telles lectures se voient régulièrement disqualifiées par la communauté savante au motif qu’elles seraient « anachroniques », « paraphrastiques » ou « puritaines ».
Pour autant, l’intérêt de ces trois essais tient moins à ce qu’ils réfutent des lectures qui les ont précédés qu’à ce qu’ils proposent de faire, collectivement et au présent, avec les textes du canon littéraire. Jennifer Tamas revient ainsi sur ce que son livre doit à son métier d’enseignante de littérature française aux États-Unis. C’est dans le cadre de ses cours, explique-t-elle, qu’elle a élaboré une méthode « inductive » qui « suppose de partir de celles et ceux qui sont en face [d’elle] ». Il s’agit de les « inviter à relire les classiques » afin de « révéler un matrimoine oublié et de convier les voix dissidentes des siècles anciens à la conversation féministe ». Dans le livre de Lucile Novat, ce sont les notes en bas de page qui portent l’horizon d’une adresse et d’une réflexion collective. Exploitant de manière inattendue les marges de l’essai, d’habitude dévolues aux références théoriques, l’autrice tisse avec délicatesse son interprétation du conte à sa propre histoire ainsi qu’à l’expérience de celles et de ceux qui l’entourent. Parlant du chaperon et du loup, elle retrace par fragments l’histoire de sa mère et de ses grands-parents. Elle rapporte aussi les paroles des collégiens et des collégiennes auxquels elle enseigne. Montrant qu’un cours de français peut contribuer à la libération de la parole et de l’écoute sur les violences intrafamiliales, elle retranscrit avec justesse et pudeur leurs réactions, dans une longue note qui vient donner corps et voix, au-delà des statistiques désormais connues, à l’omniprésence effarante des abus subis par les enfants.
Ces trois livres avancent ainsi, par des sentiers différents, sur une même ligne de crête. Il s’agit pour les essayistes de faire tenir ensemble un sentiment d’urgence face aux violences qui rythment l’actualité et le désir de se tourner, pour y répondre, vers les écrits du passé. Il s’agit aussi de déployer, à propos des textes, des savoirs, mais sans exclure les lecteurs et lectrices non spécialistes. Dans la lignée d’essais féministes ayant bénéficié de très larges tirages, comme ceux de Mona Chollet ou de Liv Strömquist, les autrices n’hésitent pas à faire cohabiter références savantes et pop culture. Certains lecteurs, certaines lectrices pourront ne pas se reconnaître dans le dispositif d’adresse très large que ces ouvrages s’efforcent ainsi de construire, en convoquant, pour parler de littérature, Marilyn Monroe ou Bertrand Cantat, les films d’animation Disney, Twilight et les chansons de Jean-Jacques Goldman. D’autres pourront se formaliser des tournures orales dont Lucile Novat joue pour susciter la connivence, ou rester sceptiques à l’idée qu’on puisse, comme le proposent les autrices de Pour en finir avec la passion, appliquer à des personnages de fiction les critères du fameux DSM, le Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux. Ces trois essais contestent, par différents moyens, un élitisme qui, aux yeux de leurs autrices, condamne le canon littéraire à l’oubli. Ils entendent construire une communauté de lectrices et de lecteurs que rassemblent à la fois une conscience politique commune et des références culturelles diversifiées.
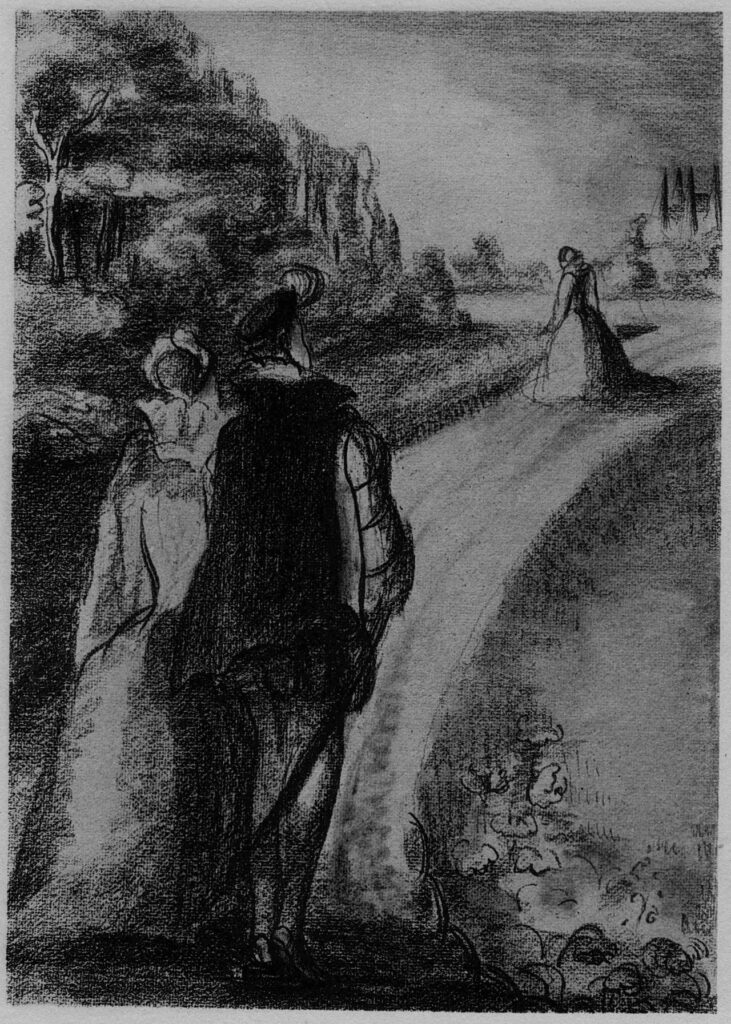
Avancer sur une ligne de crête présente toujours un risque, et tous les textes ainsi commentés n’en sortent pas approfondis avec le même bonheur. Mais on aurait tort de réfuter ces essais en bloc au motif que la lecture qu’ils proposent n’est pas « littéraire ». L’ampleur des enjeux et l’urgence de la situation n’excluent pas qu’on continue de jouer avec les textes sans se barricader dans le sérieux. C’est ce à quoi invite Jennifer Tamas, dont la capacité à rendre les textes vivants est sensible dans chacune des pages qu’elle écrit. C’est aussi ce que réussit tout particulièrement Lucile Novat, qui se réclame aussi bien de Virginia Woolf que de Pierre Bayard, et qui défend l’idée de « plusieurs lectures, plusieurs couches de sens possibles, même si celles-ci paraissent parfois contradictoires à l’esprit en éveil ». Son « écoute flottante du conte » réussit, comme le rêve, à concilier les contraires. Elle permet de lire attentivement tout en prenant le risque d’écrire, de s’inscrire dans un héritage féministe sans évacuer les apports théoriques de la psychanalyse. Elle fait se côtoyer le familier et des phrases qui s’ouvrent comme des poèmes. Surtout, elle pratique une herméneutique non autoritaire, dans laquelle un positionnement politique ferme n’exclut pas le frissonnement du sens. En cela, De grandes dents constitue certainement le plus littéraire de ces trois essais.
Pourtant, au-delà des lectures particulières qu’elles déploient, au-delà des formes distinctes qu’elles adoptent et inventent, ces cinq autrices ont sans doute plus en commun qu’il n’y paraît. Pour penser les violences sexuelles depuis la littérature, elles invitent à éviter la myopie qui consisterait à se limiter aux œuvres du présent. Elles démontrent combien les luttes qu’investissent les féministes d’aujourd’hui gagnent à pratiquer le compagnonnage avec les textes d’hier. Il s’agit pour cela de faire émerger dans les fictions que nous pensions connaître d’autres textes possibles, des trajectoires alternatives, des refus passés sous silence et des morales inattendues. Il s’agit aussi de faire retour sur ce que nous avons appris à lire et à voir dans les œuvres. Il s’agit enfin de construire, à côté de corpus contemporains plus évidents ou plus immédiats, à côté aussi des grandes figures matrimoniales, de Wittig à Woolf, une bibliothèque féministe personnelle au moyen de l’actualisation. Nul doute qu’il y a de l’impertinence, du jeu et de l’espoir dans ce détournement, qui invite à faire non seulement contre la culture et les interprétations dont nous héritons, mais aussi à faire avec, sans forcément jeter les textes du passé avec l’eau du bain patriarcal.







![Carol J. Adams, La politique sexuelle de la viande. Une critique féministe végane, Le passager clandestin, 2025 [1990], 384 pages, 25,00€ Myriam Bahaffou, Tristan Lefort-Martine, L’écoféminisme en défense des animaux, Cambourakis, 2024, 240 pages, 22,50€ Amanda Castillo, Tu seras carnivore, mon fils, Textuel, 2025, 160 pages, 17,90€](https://www.en-attendant-nadeau.fr/wp-content/uploads/2025/03/Carcass_of_Beef_by_Chaim_Soutine_c._1925_Albright-Knox_Art_Gallery.jpg)



![Amadou Barry, Journal d’un exilé, Paris, Julliard, 2025, 253 p. Abdoulaye Soumah, avec Thomas-Louis Novillo, Je ne voulais pas partir, Paris, Grasset, 2025, 123 p. Amets Arzallus Antia, Ibrahima Balde, Petit frère. Miñan [2020], tr. de l’espagnol par Roland Béhar, Paris, Payot, coll. « Bibliothèque Rivages », 2024, 203 p. Collectif La Famille Rester. Étranger, Rester. Étranger, Montreuil, B42, coll. « Sentiers », 2024, 208 p. Taina Tervonen, Les veilleurs. Cinq vigies, autour des frontières](https://www.en-attendant-nadeau.fr/wp-content/uploads/2025/03/33677313943_b7d3b5f635_k.jpg)
