Pendant trois quarts de siècle, Lovecraft incarna les mauvais genres : des tentacules et des adjectifs en excès grouillant sur le mauvais papier des pulps pour flatter les instincts immatures de frustes lecteurs. De son vivant, les éditeurs de science-fiction manifestèrent peu d’enthousiasme pour des nouvelles jugées trop longues et pas assez mouvementées. Son entrée dans la Pléiade consacre donc évidemment un changement de statut. Et c’est l’occasion de se demander pourquoi un écrivain si mal parti n’a cessé avec le temps de gagner audience et reconnaissance littéraire.
Depuis que les œuvres de Lovecraft, mort en 1937, sont tombées dans le domaine public en France, le 1er janvier 2008, les nouvelles traductions se sont multipliées. Citons celles de François Bon aux éditions du Seuil à partir de 2015, et l’intégrale de David Camus chez Mnémos, avant cette Pléiade réalisée par un collectif dirigé par Philippe Jaworski. En focalisant l’attention sur les textes, cette vague de traductions met l’accent sur Lovecraft en tant qu’écrivain et non plus seulement comme créateur d’un imaginaire très personnel. Elle propose aussi des versions plus fidèles aux originaux, car pendant longtemps les traductions françaises sont restées problématiques – dans l’édition Bouquins de 1992, Francis Lacassin indique en note : « Compte tenu de l’importance de plus en plus grande occupée par Lovecraft, nous aurions souhaité procéder à une nouvelle traduction de ce texte mais, contractuellement, cela ne nous a pas été possible » –, elles étaient même parfois tronquées.
Dans cette Pléiade, qui prend le parti de suivre les textes originaux de près, le travail de traduction, globalement remarquable, permet d’apprécier pleinement la qualité littéraire de, entre autres, « L’ombre qui planait sur Innsmouth », « La couleur d’outre-ciel », « Ce qui vit dans la nuit » ou Dans les montagnes du délire. Des textes où la monstruosité se tient principalement hors champ, en attente et menaçante, où les descriptions, rigoureuses, géométriques, frôlent parfois l’abstraction, révélant un Lovecraft très éloigné de ses caricatures.
L’entrée de Lovecraft dans la Pléiade, c’est peut-être le constat inconscient que nous avons besoin de grands récits pour exprimer les émotions que produit notre situation contemporaine.
Ce recueil réunit un choix de vingt-neuf « récits », par ordre chronologique d’écriture. Il comprend les principales nouvelles et novellas, à l’exception de « The Statement of Randolph Carter » et surtout de The Dream Quest of Unknown Kadath. On peut le regretter dans la mesure où ces deux textes forment un ensemble avec « La clef d’argent » et « À travers les portes de la clef d’argent », qui ont le même héros, Randolph Carter, alter ego de l’auteur explorant les Contrées du rêve.
Le succès de Lovecraft a d’abord reposé sur son originalité en tant que créateur de mondes. Les vingt-neuf récits présentés ici permettent de voir se construire au fur et à mesure – et non selon un plan préétabli – une cosmogonie incomplète et fautive, raturée et contradictoire, telle que l’établiraient des humains n’en ayant qu’une compréhension parcellaire, pleine de trous et de résonances tordues. Dans la littérature, cités perdues et hameaux sinistres abondent. Le génie de Lovecraft, ce sont les entités cosmiques et indifférentes qui les hantent, extérieures ou pétrifiées, mais sur le point de forcer la frontière ou de se réveiller.
Ces dieux qui n’en sont pas – insensibles et colossaux, les humains leur indiffèrent – se dressent à l’image de la modernité terrible du XXe siècle. La ville titanesque de Dans les montagnes du délire évoque les architectures soviétiques et fascistes comme les mégalopoles nord-américaines. Qu’elle soit déserte et écrasante en fait un écho – non une allégorie – de ces totalitarismes, comme Kafka d’une certaine manière les annonce dans Le procès et Le château.
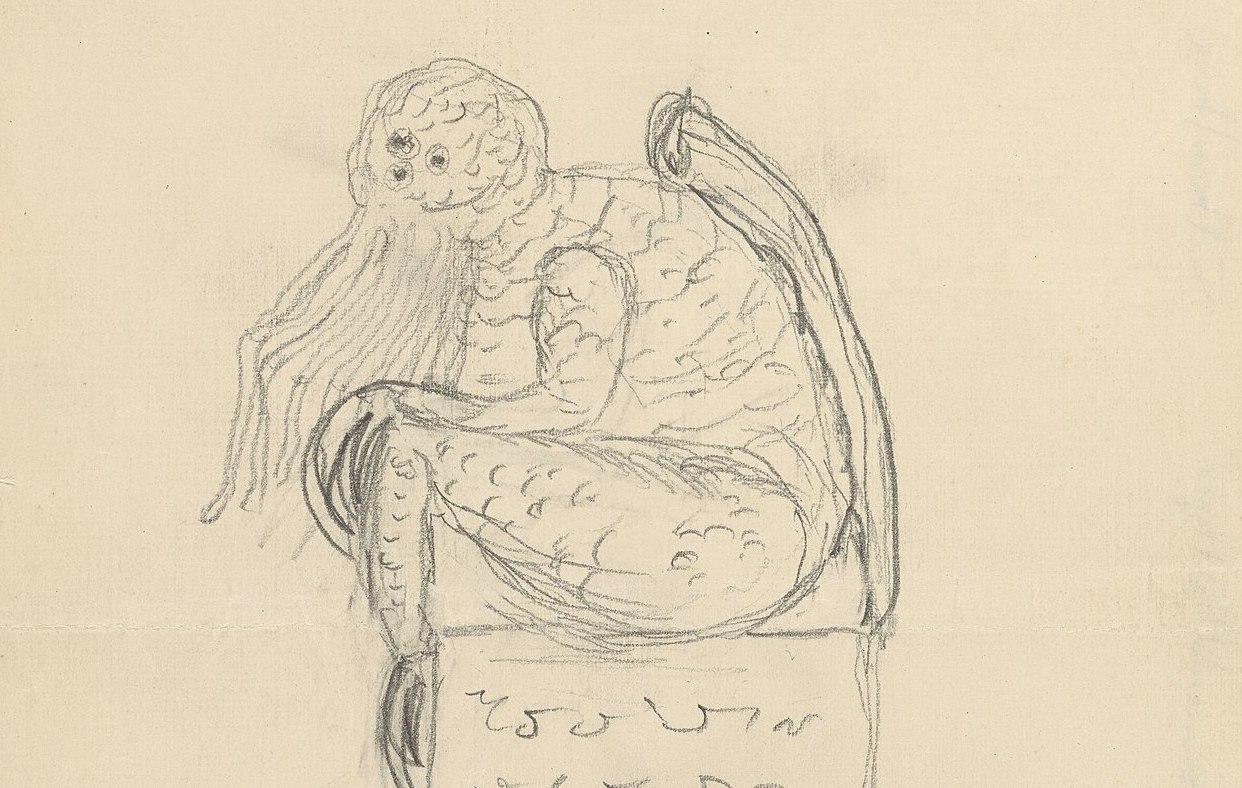
Ainsi que l’écrit Laurent Folliot dans son excellente introduction, « la ville transfigurée est l’une des images les plus puissantes de l’imaginaire lovecraftien ». Ses architectures, la ville sans fin des Montagnes du délire ou la R’lyeh aux angles non euclidiens de « L’appel de Cthulhu », « gagnent une présence solide, une sorte de vraisemblance brutale, peut-être parce qu’elles anticipent les angoisses de la concentration urbaine qui allaient travailler le XXe siècle sans cesse davantage ».
À travers une esthétique de la ruine, ces récits rappellent que les civilisations sont mortelles : d’autres races ont semé la Terre de vestiges qui resurgissent dans le désert australien (L’ombre d’outre-temps), l’Antarctique ou le Pacifique comme autant de memento mori. Les points communs entre la civilisation des Montagnes du délire et l’humanité sautent aux yeux ; or cette culture préhumaine a été détruite par une de ses créations de génie génétique mal maîtrisée. La décrépitude, qui caractérise de manière obsédante la Nouvelle-Angleterre, souligne que l’humanité et plus spécifiquement l’Occident n’échappent pas à cette vulnérabilité. Au cœur des campagnes américaines se tapissent des forces invisibles qui en rongent la vitalité, comme dans « L’horreur de Dunwich » ou « La couleur d’outre-ciel », jusqu’à la stérilité : « Les cinq arpents gris et dévastés qui s’étalaient sous le ciel telle une grande tache rongée à l’acide ». Il faut noter que l’horreur lovecraftienne n’a pas de limites géographiques. En trois brèves parties – les rêves d’un sculpteur de Providence, l’enquête d’un policier de La Nouvelle-Orléans, le journal d’un marin ayant sillonné le Pacifique –, « L’appel de Cthulhu » donne une idée d’une horreur planétaire, suggérant que nulle partie du monde n’y échappera. Les récits prenant pour cadre la Nouvelle-Angleterre rurale montrent bien qu’aucun lieu, si privé, retiré, paisible soit-il, n’est à l’abri.
Lovecraft écrit les récits réunis dans la Pléiade entre 1917 et 1935. Exprimée différemment, on y trouve la même noirceur que dans les merveilleux textes scientifiques français de l’époque, La mort de la Terre (1910) de J.-H. Rosny Aîné, Le péril bleu (1911) de Maurice Renard, Quinzinzinzili (1935) de Régis Messac ou La guerre des mouches (1937) de Jacques Spitz. L’auteur de « Dagon », on le sait par sa correspondance, était soucieux du monde. Ses récits d’horreur n’ont pas pu ne pas être affectés par le traumatisme de la Première Guerre mondiale, la crise de 1929, la montée des fascismes, la menace de la Seconde Guerre. Mais leur angoisse, cosmique, antique, est suffisamment transfigurée pour ne pas apparaître propre à une époque. Elle peut donc être réinvestie par différentes générations de lecteurs. Ce n’est sans doute pas un hasard si l’intérêt pour cette œuvre s’est avivé au début du XXIe siècle. On voit bien quels échos le texte lovecraftien peut faire résonner de nos jours, avec les inquiétudes liées à l’environnement, au climat ou aux manipulations de la vie.
Cela a été maintes fois souligné : l’écrivain de Providence dépeint l’humanité comme microscopique et insignifiante dans un cosmos indifférent. L’entrée de Lovecraft dans la Pléiade, c’est peut-être le constat inconscient que nous avons besoin de grands récits pour exprimer les émotions que produit notre situation contemporaine, largement étouffée par les discours officiels. Cthulhu, Yog-Sothoth, les Anciens à tête d’étoile peuvent incarner les inquiétudes civilisationnelles successives du XXe et du XXIe siècle, et sans doute plus encore aujourd’hui que par le passé.
Laurent Folliot souligne à juste titre que, chez Lovecraft, « le sujet vacille au bord d’un grouillement où il risque de se perdre sans retour », l’identité de personnages sans grande profondeur est souvent menacée, jusqu’à la fréquente dissolution dans l’étrangeté. Le héros de L’ombre d’outre-temps se retrouve exilé dans un corps extraterrestre, celui de « La chose sur le seuil » obligé d’habiter un cadavre. Randolph Carter, « À travers les portes de la clef d’argent », subit un éparpillement traumatisant dans une multitude d’êtres et d’espaces-temps. Constamment, l’œuvre affirme la hantise de l’informe. Ainsi, comme l’écrit Agnès Derail dans la notice d’« À travers les portes de la clef d’argent », ces contes ne sont pas « sans affinité avec un certain modernisme, celui de l’impersonnalité, de la dislocation des formes, des changements d’échelle et de vitesse ». Là encore, Lovecraft est notre contemporain.

Comme Philip K. Dick, il ne cesse de dévoiler de fausses apparences. Le thème du masque revient dans « À travers les portes de la clef d’argent », « L’horreur de Dunwich », « La chose sur le seuil », où à chaque fois un personnage incomplètement humain se déguise pour paraître humain. Mais, au contraire des textes dickiens et de la majorité des littératures de l’imaginaire, chez l’auteur de « L’ombre qui planait sur Innsmouth », et c’est là une de ses originalités, l’accès à la vérité, à la connaissance, le dévoilement ne sont jamais une libération. Ils conduisent à une angoisse exacerbée, qui se résout souvent en folie, en destruction de la personnalité. Ici, Lovecraft se montre plus écrivain fantastique que de science-fiction.
L’œuvre de Lovecraft a une plasticité symbolique à même de résonner avec les tourments de notre temps tout en nous donnant un aperçu de la grandeur.
Si elle n’offre pas de solutions à des personnages fréquemment passifs, si elle ne leur permet pas d’agir – sinon de manière ponctuelle et temporaire, et souvent dans les moins bons récits de l’auteur –, la connaissance est pourtant désirable dans la mesure même où elle désespère : par sa dimension cosmique. Celle-ci offre l’horreur et l’émerveillement en même temps, la terreur de l’abîme et sa vastitude, bien plus intéressantes que le fade quotidien, à peu près absent chez Lovecraft.
Les héros lovecraftiens savent qu’ils devraient faire demi-tour. Bien que Dyer et Danforth aient vu les corps de leurs compagnons disséqués et mutilés, ils se précipitent dans les montagnes inconnues. Le narrateur de « L’ombre qui planait sur Innsmouth » a été prévenu que, si on le voyait parler à Zadok Allen, il risquait de disparaître comme d’autres étrangers trop curieux. Il n’en reste pas moins plusieurs heures à découvert, en plein air, à discuter avec le vieil ivrogne. S’apercevoir que l’humanité n’est rien ou presque et que des entités monstrueuses la menacent, c’est le prix à payer des « mirages » de cités antarctiques, « labyrinthe bouillonnant de murs, de tours, de minarets » ; du « clignotement des lumières déconcertantes situées au-delà de la Première Porte » qui provoquent chez Randolph Carter d’abord « l’épouvante », avant que « ce qu’il avait trouvé jusque là anormal et démoniaque lui apparût seulement d’une majesté ineffable » ; des étoiles qu’aimait tant le jeune astronome amateur Howard. Quant au protagoniste de « L’ombre qui planait sur Innsmouth », il choisit finalement de se fondre dans l’horreur merveilleuse. Le personnage lovecraftien sacrifie sa santé mentale au grotesque et au sublime amalgamés en un alliage qui refond le romantisme en modernité.
Laurent Folliot, dans la notice de Dans les montagnes du délire, considère cette novella comme « le couronnement de la méthode lovecraftienne consistant à multiplier les points d’orgue par la pratique systématique du redoublement et de la surenchère ». Ainsi, l’horreur lovecraftienne postule toujours un au-delà conférant son dynamisme à la fiction. Comme les personnages, le lecteur désire aller plus loin. Et on peut penser que, si les narrateurs, tout en proclamant qu’ils ne le veulent surtout pas, racontent leurs expériences, ce n’est pas, contrairement à leurs affirmations, pour mettre en garde leurs téméraires successeurs, mais pour les appeler à poursuivre ce qu’eux sont incapables de continuer sans sombrer dans la folie. « Viendront d’autres horribles travailleurs ; ils commenceront par les horizons où l’autre s’est affaissé »…
Lovecraft est profondément un écrivain des lieux. On s’en rend compte à la lecture de ses descriptions. Elles participent de « ce parti-pris de la lenteur et de la longueur » que Laurent Folliot signale à juste titre comme étant caractéristique de l’écriture d’un écrivain qui avance aussi bien par effets de retard que par « chocs répétés et successifs [qui] finissent par confondre et amplifier leurs réverbérations », et qui se révèle maître dans la création des atmosphères spatiales : la portuaire Innsmouth est aussi plate et nette que les collines autour de Dunwich sont raides, étouffantes et agitées. Comme une lumière côtière s’opposerait à celle de sous-bois vallonnés. La verticalité et l’obscurité de « Ce qui vit dans la nuit » lui donnent presque la forme d’une épure, tandis que quelques pages de « L’appel de Cthulhu » suffisent à faire naître une géométrie « abominablement évocatrice de sphères et de dimensions distinctes des nôtres ». La précision avec laquelle les déplacements dans la ville des Anciens ou dans Innsmouth sont narrés crée un effet quasi hypnotique contribuant au sentiment d’étrangeté, sense of wonder et malaise mêlés, propre à l’écrivain de Providence.
« Cthulhu fhtagn », « Cthulhu attend », ont coutume de répéter ses adeptes. Aujourd’hui, son modernisme, « en mineur » selon Laurent Folliot, l’aspect à la fois très visuel et abstrait de certaines images, en particulier les trouées sur l’immensité spatiale, donnent à l’œuvre de Lovecraft une plasticité symbolique à même de résonner avec les tourments de notre temps tout en nous donnant un aperçu de la grandeur. Cthulhu bouge. On peut s’en réjouir au moins d’un point de vue littéraire. Et quant à l’état du monde « réel », ces textes peuvent peut-être nous aider à mieux l’envisager.












