Le contexte comme terre d’aventure est au cœur de cette chronique. On y croise l’insurrection poétique que fut l’œuvre de Friedrich Hölderlin, la langue et les mythes du tyran entouré de ses foules séduites que décortique Carlo Emilio Gadda ou les jeux entre langues dans le journal intime de la poète chilienne Gabriela Mistral. Emmanuelle Pireyre tente d’en faire une théorie en se concentrant sur les machines et anti-machines qui enserrent les textes.
Friedrich Hölderlin naquit en 1770. C’est l’époque très européenne des « Lumières » allemandes (Aufklärung). Karl Philipp Moritz, l’auteur du prodigieux Anton Reiser, vient de jeter, dans sa revue Magazine expérimental de psychologie expérimentale (Magazin zur Erfahrungsseelenkunde), les fondations de ce qui deviendra, un siècle plus tard, la psychanalyse. Alexander von Humboldt est l’un des premiers à faire l’exploration scientifique de l’Amazone et son frère Wilhelm sera l’un des premiers linguistes modernes. Goethe, lui, ouvre toutes les portes aux jeunes poètes.
Ce fut une époque d’exaltation et de mouvements intellectuels majeurs. La révolution française eut ainsi un retentissement énorme dans la jeunesse étudiante, celle du Stiftt (le séminaire protestant) de Tübingen, en Souabe, en particulier, où Hölderlin fut élève, tout comme ses amis les philosophes Hegel et Schelling, trio d’exception qui joua un rôle essentiel dans l’évolution intellectuelle de l’Allemagne.
Hölderlin est comme l’inventeur de temps nouveaux de la langue poétique. Personne, peut-être, ne l’avait à ce point située et confirmée dans sa dimension réelle. La poésie de Hölderlin recèle une rythmique particulière et universelle, comme celle de Rimbaud. Hölderlin a fait naître une nouvelle grammaire poétique jusqu’au sein de la versification. La fermentation, jusqu’à l’éclatement, sera l’essence de toute son œuvre (de 1800 environ à sa mort en 1843).
Le germaniste Pierre Bertaux, qui fut un grand résistant et, de 1949 à 1952, le directeur de la Sûreté nationale, a écrit sur Hölderlin un beau livre, Hölderlin ou le temps d’un poète (Gallimard, 1983), il rappelle l’importance de l’amitié intime du jeune diplomate Isaac von Sinclair qui prit en charge, pendant plusieurs années, Hölderlin, déjà malade (Hölderlin Variationen, Suhrkamp).
Curieusement, c’est par l’intermédiaire du militant nazi Heidegger, philosophe à la mode, que Hölderlin fut véritablement introduit en France et promu par les heideggeriens de Paris. Terrible paradoxe de plus, il avait, lui aussi, servi d’emblème de germanité aux nazis. Or, Hölderlin, comme Rimbaud, incarne l’insurrection poétique par-delà toute appartenance, surtout de cette sorte.
Les poèmes de cette première édition française complète et bilingue ont été magnifiquement introduits et traduits par François Garrigue. Ces traductions font voir à quel point Hölderlin est à tous et à personne. Georges-Arthur Goldschmidt

Figée dans la mémoire nationale chilienne, dans le canon poétique latino-américain, dans la liste des Prix Nobel de littérature, ou dans celle, plus restreinte, des femmes ayant mérité ce prix, la figure de Gabriela Mistral gagne à être ranimée. Voici, après Pressoir, recueil poétique paru l’an dernier aux éditions Unes, Bénie soit ma langue. Journal intime, publié par les éditions Des femmes-Antoinette Fouque. L’image quelque peu austère que l’on a de sa personne – l’exemplaire pédagogue du Chili, la féministe, la célibataire éprise des enfants, émue par le sort des mères – se diffracte ou se nuance dans cette suite de « cahiers de vie », dont les titres disent les lieux et les étapes d’une vie de pérégrinations.
Gabriela Mistral éprouve avec force chacune de ses « résidence[s] sur la terre », d’abord au Chili, puis au Mexique où, dès les années 1920, elle accompagne la politique d’instruction publique du gouvernement post-révolutionnaire, enfin, au fil de la carrière consulaire qui la mène d’Amérique en Europe et d’Europe en Amérique. Elle goûte régions, pays et séjours, dont elle confie à son journal les impressions tout comme ses tribulations de directrice d’école, de spécialiste en pédagogie, de consule. Ce faisant, elle dresse aussi de spontanés tableaux critiques des injustices sociales et raciales au Chili, des préjugés des Espagnols envers les ressortissants et les cultures d’Amérique latine, de l’état du monde durant la guerre froide. Se vivant en « errante » après la mort de son fils adoptif en 1953, elle demeure attachée, charnellement, au souvenir de la vallée tout en contrastes qui l’a vue grandir. Elle-même, qui, sujette à des sautes d’humeur, se compare à sa vallée de l’Elqui, se montre faite de force fragile, savoure les fruits de la terre, peste contre l’administration publique, s’émerveille de la beauté du monde et de ses plus simples habitants. Gabriela la poète écoute les parlers de l’espagnol au Mexique ou en Castille, découvre la langue mapuche des Indiennes de l’Araucanie, ce « roucoulement de tourterelles sur l’étendue des blés ». Bénie soit sa langue ! Florence Olivier
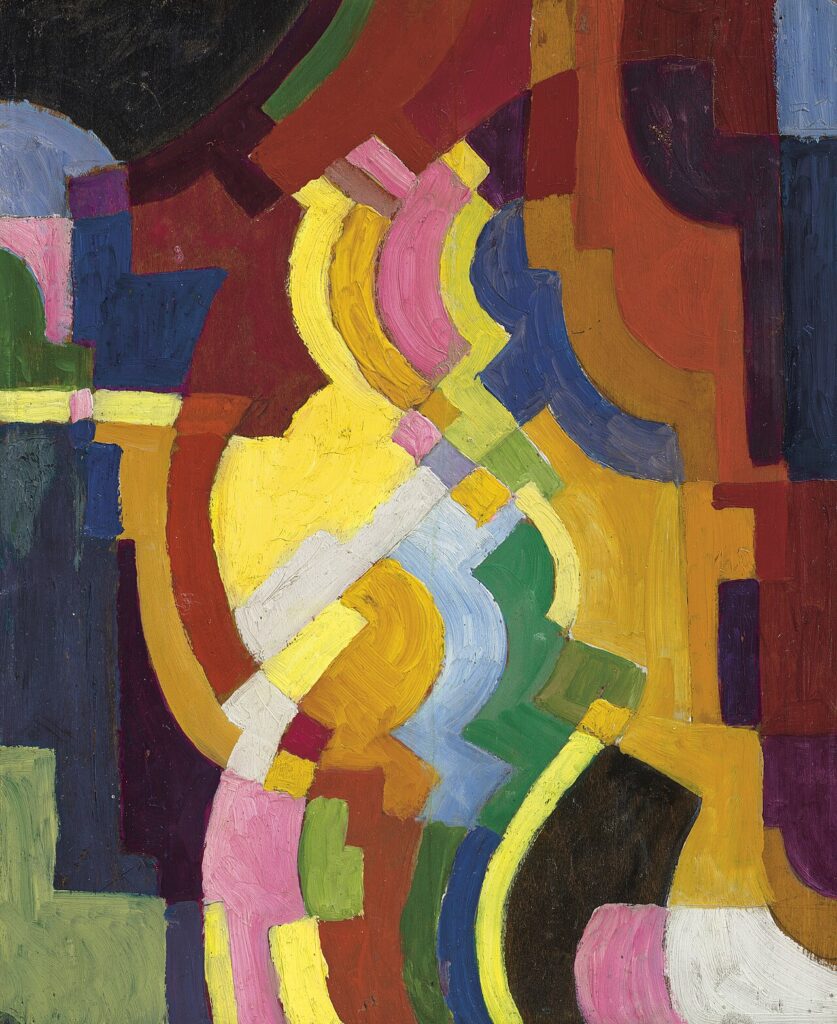
« Un débile paranoïaque enchanta, en qualité de “génie”, de “prophète”, d’“homme envoyé par la Providence”, des millions d’Italiens et de femmes italiennes […]. Il trouva dans son incommensurable trivialité le pentacle de la magie facile, la formule dégueulasse et l’instrument inutile de l’enchantement » – voilà ce qu’écrit Carlo Emilio Gadda en 1944 dans Les mythes du baudet, à propos d’un infâme Duce à tête de chou (échantillon reproduit judicieusement en quatrième de couverture). C’est bien connu : selon Hegel, l’histoire se répète, la première fois comme tragédie, la deuxième comme farce ; mais que se passe-t-il quand la première fois ressemble déjà à une farce tragique ? De quoi aura l’air sa réplique ? Cette question trouvera sa réponse sous nos yeux ; on sait seulement qu’elle sera protéiforme et méphitique.
Éros et Priape, écrit entre 1946 et 1965 et publié en 1990 aux éditions Bourgois, n’est plus disponible ; Gadda y déployait le plus savoureux de sa manière – une manière, disons, injurio-lettrée, ou insulto-savante jetée à la figure d’un Benito jamais nommé. Faute de ce Priape qu’il faudrait ressusciter, les éditions Van Dieren donnent à découvrir ces Mythes, sorte de pré-Priape, étourdissante mise en bouche, fulminante incitation à lancer des noms d’oiseaux savamment choisis à toutes les badernes couronnées, acclamées ou élues. Mine de rien, sans perdre sa fougue de basse bouffe (basso buffo), Gadda propose une interprétation psychologique et mythique du tyran entouré de ses foules séduites ; elle ne changera pas la course désastreuse de notre monde mais, Dio maiale, elle vise juste.
Une introduction du traducteur, Jean-François Lattarico, montre comment « l’éloquence gaddienne » sert d’outil contre les boniments creux de l’Âne. Le texte est publié dans les deux langues ; l’amateur pourra ainsi déclamer les diatribes raisonnées de Gadda en version originale, au milieu de sa cuisine, dans une lumière de crépuscule et de salami. Pierre Senges
Depuis 2019, l’Institut Mémoires de l’édition contemporaine demande à des écrivains (français) de parler de leur travail à partir d’images de leur choix, dans sa jolie collection « Diaporama ». Le résultat est de très brefs textes qui échappent au format de la conférence ou du commentaire, pour articuler une poétique à chaque fois personnelle. Après Tanguy Viel, Maylis de Kerangal, Thomas Clerc, Philippe Artières, Olivia Rosenthal, Stéphane Bouquet et Olivier Cadiot, voici qu’Emmanuelle Pireyre (bientôt la parité !) navigue aussi adroitement que joyeusement entre narration et réflexion, entre récit d’une performance et théorie d’une littérature en acte.
À propos du dernier livre d’Emmanuelle Pireyre, Chimères (L’Olivier, 2019), Marie-Jeanne Zenetti avait parlé ici même d’une fiction comme « machine à délire ». Il est aussi question de machine ici, et d’abord d’une ancienne, la télévision : le texte s’organise en dix jours, rendez-vous à 20 h, car quel meilleur horaire pour capter l’auditoire ? Il sera ensuite question de machine à laver, de téléphone, de casque anti-bruit, de domotique, de reconnaissance faciale, d’un grand-père formé par Jules Verne… et surtout du livre comme machine accueillante, susceptible d’inclure « un maximum de monde » et de toujours renouveler la curiosité pour son propre fonctionnement. Alors que « la machine du monde réel, on la connaît déjà suffisamment, on en a soupé ».
Tout cela pourrait conduire à un texte jouant à son propre démontage. Il n’en est rien. Dans un monde où les machines s’en occupent, il est plus difficile de reconstruire des récits que de poursuivre leur démolition : « L’écriture a beaucoup déconstruit, brisé, pulvérisé depuis quelques siècles. Mais voilà la difficulté qui surgit devant nous : qu’est-ce qu’on décompose quand l’ensemble du paysage est déjà désagrégé en fragments hurlants, en fragments gesticulant sur son caillou brûlant ? Il faut recoudre et pacifier. » Faisant corps avec les machines, ce texte non machinal cherche une voie vers « l’anti-machine organisée ». Elle s’ouvre au jour 10. Pierre Benetti












